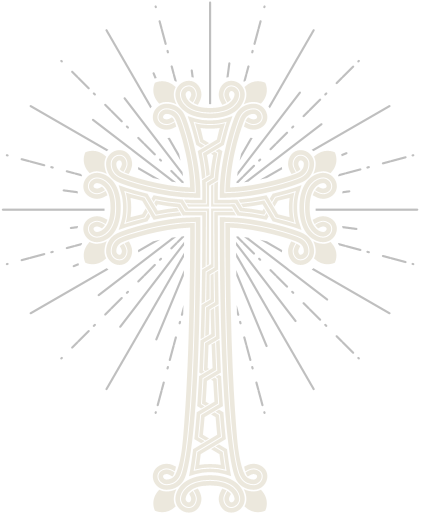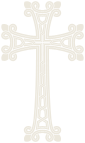INTERVIEW DE MONSEIGNEUR NORVAN ZAKARIAN
PAR MARC NICHANIAN
Les lignes qui suivent sont le produit d’une amitié déjà ancienne et d’une discussion récente.
Lors de notre dernière rencontre avec Monseigneur Norvan Zakarian, nous en sommes venus
ensemble à cette conclusion qu’il n’était peut-être pas vain de rendre publique une réflexion sur la
situation actuelle de l’Église Apostolique Arménienne ; c’est-à-dire aussi sur le rôle qui est ou
devrait être le sien dans la diaspora, en un mot, sur sa vocation dans la dispersion.
Chez les arméniens de France tout particulièrement, l’Église (mais il est vrai, pas seulement elle)
traîne une existence plutôt mythique, aux limites de l’exotisme. Elle est le ciment et la garantie de
l’unité nationale et de l’auto-conservation. C’est ce que l’on entend le plus souvent à son propos.
Mais, ce qu’elle est en réalité, de l’intérieur, ce qu’elle porte en elle en matière de foi et de
Tradition, cela demeure la grande inconnue.
Elle est l’exécutrice des hautes œuvres dans les circonstance familiales heureuses ou tragiques.
Mais de là à devenir le creuset communautaire d’une collectivité, ou l’objet d’une saisie
d’ensemble, il y a un sérieux pas, jamais franchi. Il faut ajouter encore ceci: la communauté
arménienne de France n’est jamais mise au fait des évènements très concrets qui peuvent avoir lieu
dans cette institution particulière qu’elle revendique pourtant comme sienne.
Pour les simples mortels que nous sommes, ce qui s’est passé par exemple en France durant ces
derniers mois reste une pure énigme. Or, il y a un sujet constant et rebattu de mécontentement:
l’absence de participation des fidèles à la vie interne de cette Église. Mais, une telle participation
supposerait en retour la volonté d’informer. Les habitudes en usage dans ce domaine appelleraient
pour le moins une réforme.
Au-delà de la discussion et de l’échange entre deux personnes, il y a ici de ma part un véritable
engagement. L’acte de la pensée et le vécu communautaire ne peuvent pas être, dans le cas présent,
distincts l’un de l’autre. Et la sphère des idées ne fait en somme que refléter le destin des forces les
plus intimes d’un peuple. On dilapide un héritage, on laisse se défaire le nœud communautaire, on
manque au devoir de l’information. Ce ne sont là que les divers aspects et degrés d’un même
phénomène.
Ce qui a été dit avec Monseigneur Zakarian au cours de la présente conversation se situe quelque
part entre l’interview et l’échange d’idées. Je reprends, je condense et je reproduis la discussion
sous ma propre responsabilité. La première partie aura plutôt la forme d’un condensé personnel, la
seconde plutôt celle de l’interview. Ce n’est à chaque fois qu’un choix de forme. La rencontre avait
lieu à Lyon. Elle n’avait rien de programmé. J’avais bien au départ quelques questions liées à
l’actualité immédiate. Mais sans plus. Ce n’est qu’au cours de la conversation que l’idée est née de
rendre publiques les questions débattues et les éclaircissements apportés.
Ma première question avait trait bien sûr à ce court article paru récemment dans le quotidien en
langue arménienne « Յառաջ – Haratch » paraissant à Paris. L’article, exceptionnellement, était
publié en français sous le titre « Théologie de l’exil ». La possibilité d’une « Théologie de l’exil « a
toujours été l’une des préoccupations les plus constantes de Monseigneur Zakarian. Est-ce que cet
article provenait d’une suggestion directe de sa part ? Je dois rappeler que l’article en question signé
par Dom Bouttier proposait en une colonne en certain nombre de références obligées aux deux
Testaments et réduisait ensuite toute la difficile question d’une « Théologie de l’exil », une fois de
plus, à un problème purement politique, en mettant l’accent sur les dernières déclarations papales
concernant les réfugiés en Asie du Sud-Est. Ce que nous avons ainsi eu l’occasion de lire dans
« Haratch » était certes une déclaration d’amitié envers les arméniens, et il faut probablement en
être reconnaissant. Elles sont trop nombreuses. Mais il n’en est pas moins sûr qu’un titre aussi
ambitieux ne s’imposait pas pour un contenu aussi limité. Monseigneur Zakarian se demandait
comment, par quels détours, l’idée et la nécessité de développer une « Théologie de l’exil » avaient
pu aboutir là. Ce n’étaient plus les voies de la Providence divine, c’étaient les voies très encombrées
de l’industrie humaine. Plus tard, notre conversation allait revenir aux questions essentielles, et
j’allais avoir l’occasion de demander ce qu’étaient le projet et la dimension de cette « Théologie de
l’exil ». Il était cependant clair que la réalisation d’un tel projet, le respect de sa véritable
dimension, ne pouvaient être atteints que dans la tension de la pensée et qu’avec le souffle d’une
réflexion érudite.
Au début du volume 9 de son « Panorama de la littérature arméno-occidentale »*, Hagop Ochagan,
l’une des figures les plus marquantes de la littérature arménienne au 20ème siècle, se rappelle sa
dernière rencontre avec ses camarades , juste une semaine avant la date fatidique du 11 avril 1915.
La scène se passe dans la demeure de Rouben Sevag qui allait mourir quatre mois plus tard. Le
passage, probablement écrit en 1943, reconstitue quelques trente ans après la discussion qui avait eu
lieu à l’époque et restitue l’une des idées chères à Hagop Ochagan. J’essaie de traduire : « Il y a un
siècle et plus, l’Église était notre littérature vivante, notre canalisation éternelle, comme elle était
le réceptacle de la métamorphose secrète de l’une en l’autre. »
« Il y a un siècle et plus »…ce qui signifie qu’aujourd’hui, elle ne l’était plus. Et Ochagan ajoute
donc : « Aujourd’hui, c’était la littérature qui se faisait l’héritière de ce dessein ». Je traduis par
héritière un mot qui en arménien veut dire : ce qui remplace, tient lieu, qui vient à la place de.
Cette idée d’ « héritage » et de « lieu-tenance » vient sous la plume de Hagop Ochagan lorsqu’il
s’agit d’expliquer l’essence et la signification du mouvement littéraire lancé par sa génération
autour de la revue « Méhian » à Constantinople en 1914. je n’explicite pas ici plus qu’il n’est
nécessaire la phrase citée. Il faut remarquer cependant que quelqu’un qui, comme ici, semble être en
sa qualité de « laïque » un observateur extérieur peut proposer la plus profonde caractérisation du
devenir de l’Église arménienne. Il est vrai qu’il n’est pas n’importe qui. Il est non seulement la
figure la plus remarquable de sa génération dans son domaine, mais de plus, dans les lignes que
nous venons de lire, il se présente lui-même et sa génération comme les héritiers du « dessein »
ecclésiastique.
S’il est vrai que la littérature peut de cette façon être considérée comme ce qui hérite de l’Église, et
ceci au-delà de toutes les naïvetés et de toutes les interprétations « nationalistes », cela voudrait dire
que l’Église est parvenue là au terme de sa vocation, et que ce terme, cette fin sont en train de
s’inscrire ailleurs, dans le travail de Hagop Ochagan en particulier. Mais, cela veut dire
deuxièmement que cette vocation, d’une façon ou d’une autre, était liée à l’écrit, à la responsabilité
de l’écrit. Et enfin, troisièmement, cela veut dire qu’aujourd’hui une réflexion propre à l’Église,
qu’un retour interne à ces évènements de son passé immédiat s’avèrent indispensables. Cela ne
suppose pas seulement un engagement théologique. Cela suppose aussi une capacité certaine à
pouvoir se mesurer avec la pensée « laïque ».
Et un voici un ecclésiastique arménien, en la personne de Monseigneur Norvan Zakarian, qui fait
preuve d’une sensibilité sans précédant à de telles questions. Il a vécu au plus profond de lui-même
la crise actuelle de son Église. Il sait à quel point la réflexion et le retour interne dont nous parlions
sont devenus choses urgentes. Mais il a surtout su ouvrir en lui-même l’espace d’un dialogue entre
le « dessein ecclésiastique » et son « tenant-lieu » moderne du fait de son intérêt et de son
engagement personnels pour la littérature arménienne de la diaspora. Car la crise dont faisons état
n’est pas seulement celle de l’Église, elle est plus générale. C’est une crise qui concerne la diaspora
en son ensemble, je dirais en son essence. Et si nous comprenons bien notre interlocuteur, l’une des
voies sur lesquelles pourra être surmontée cette crise interne à la diaspora, c’est la voie d’une relève
de l’écrit par la spiritualité.
Le problème actuel de l’Église arménienne est un problème de « sens », de perte de sens.
C’est Monseigneur Zakarian qui parle. Il dit en arménien : « de contenu interne ». Qu’entend-il par
là ? Il semble que l’Église ait cessé aujourd’hui, pour garder les expressions de Hagop Ochagan,
d’être notre « canalisation éternelle », notre « littérature vivante ». Il y a là quelque chose que nous
avons cru pouvoir nommer une « perte de sens ». Elle est partout sensible. Mais elle l’est de deux
façons différentes. Elle l’est d’abord dans le fait que l’Église arménienne est étrangement incapable
aujourd’hui de développer une pensée qui lui soit propre. Monseigneur Zakarian dit : « une vision
du monde », une « conception du monde » qui soient siennes, réassumées, et réactualisées. Seule
cette réactualisation d’une « conception du monde » propre à notre Église pourrait rendre un carde
de vie et de pensée à ceux qui s’en réclament.
Quelle est aujourd’hui la position, la production de l’Église arménienne autour de questions
purement théologiques ?
Quelles sont les personnalités qui peuvent se présenter dans l’espace de la catholicité comme les
représentants d’une tradition théologique ou philosophique propre à cette Église ?
Ce sont des questions sans réponse.
Mais la « perte de sens »n’est pas sensible uniquement sur le plan théologique ou philosophique.
Car une pensée, une « conception du monde » ne sont pas choses abstraites. Elles opèrent dans le
cœur même d’une communauté, elles sont l’élément qui permet à ses membres de s’identifier. Un
même mot, « համայնացոմ – hamaïnatsoum » signifie en arménien à la fois « devenir une
communauté » et « devenir universel ». la possibilité de s’identifier est précisément ce qui
« assemble et rassemble », et ce qui permet d’être « au sein de l’universel ».
Or, Monseigneur Zakarian raconte que lorsqu’il s’est trouvé confronté à sa charge, il a soudain pris
conscience de l’immensité du travail à accomplir en ce sens. Il fallait commencer, à partir de rien,
cette tâche de l’assemblement. Comme si tout était défait, épars, et qu’il fallait rassembler à
nouveau l’épars. Comment ? D’abord en s’attachant à l’enseignement religieux. Mais aussi en
mettant les cœurs en mouvement, dans un mouvement commun de rassemblement.
« L’assemblée du peuple de Dieu » (un même mot, ժողովուդ – joghovourt, veut dire en arménien
à la fois « assemblée » et « peuple » dans le sens d’ethnie), voilà des termes qui n’auraient pas dû
perdre leur contenu. Il n’y a d’assemblée, il n’y a de peuple, que s’il se rassemble, que dans le
mouvement commun de l’assemblement, à condition donc que celui-ci puisse de nouveau s’opérer.
Monseigneur Zakarian dit : « il ne s’opérera que sur le fondement du Sacrifice Pascal ».
Comment pense-t-il, comment comprend-il le rapport entre l’assemblement du peuple an tant que
tel et celui du peuple de Dieu ? Nous avons dû laisser cette question, pourtant essentielle, de côté.
Monseigneur Zakarian aime à souligner, dans ce contexte, la nécessité de voir se créer un
« mouvement ». Il n’y a pas de « mouvement » sans une pensée qui examine. Mais il n’y a pas non
plus de « mouvement » s’il n’y a pas d’amour, ce ciment de tout assemblement. La pensée et
l’amour, l’examen théologique et le mouvement des cœurs, ce sont là les deux pôles entre lesquels
un « sens », un « contenu interne » peuvent se constituer. Et c’est bien l’union entre ces deux pôles
qu’exprime Monseigneur Zakarian lorsqu’il parle de « conception du monde » et de cet impératif
fondamental : forger une conception du monde, peut-être faudrait-il dire, une philosophie. Le travail
de la pensée, de la synthèse et de la transmission par l’enseignement, la création d’un
« mouvement ». Les deux pôles ensemble ne forment un tout que lorsqu’ils rendent possible la
constitution d’une vision du monde.
C’est ce sens unitaire qu’il faut donner, probablement, au mot arménien « պատկամ – batgam ».
C’est un mot peut-être un peu usé, qui a aujourd’hui souvent une couleur politique. Mais il faut
oublier cet aspect, négliger ce sens de message politique destiné à remuer des masses dans une
direction déterminée. Le même Hagop Ochagan, que nous citions tout à l’heure, dit ceci :
« Ils ne nous avaient pas légué de « batgam », en se référant dans un contexte différent aux
anciennes générations, dont la parole, la tradition de parole, s’était trouvée insuffisante pour que
nous puissions affronter et surmonter la tragédie la plus effroyable de notre histoire.
Et chez Monseigneur Zakarian, c’est une question à la fois obsédante et stimulante que celle-ci :
« Notre Église a-t-elle aujourd’hui un « batgam » à transmettre ? ». C’est-à-dire une parole mûre,
un recueil du passé destiné à informer le présent. A-t-elle quelque chose de tel à transmettre,
quelque chose qui seul justifierait son existence et sa pérennité ?
L’assemblée du peuple reste éparse, lorsque la Parole, le pouvoir de la Parole, a quelque part subi
un dommage peut-être irréversible, lorsque nous n’avons plus de « batgam » à transmettre.
Une oreille arménienne pourrait penser que c’est mieux ainsi , en entendant sous ce terme le mot
d’ordre, la croyance par idéologie, le rite vidé de son âme (et c’est sur le plan politique que, chez les
arméniens, les rites vidés d’âme produisent leurs plus grands dommages). Mais dans ce terme, il
faut entendre la parole enseignée, transmise et traduite dans l’actuel, celle qui tire sa force et sa
portée d’une tradition (tradition – transmission forment en arménien un seul et même concept). Cela
revient à un constant renouvellement, à une recréation de cette tradition, puisque celle-ci ne reçoit
son sens qu’en étant portée à la puissance du présent.
Krikor Beledian, dans un texte de 1978, dit ceci : « Nous n’avons pas encore réussi à interpréter la
tradition comme la loi de ce qui est à venir ». Ces mots concernent, dans leur cadre, la tradition
littéraire, sa lecture et son interprétation. Il est clair qu’elles valent tout autant pour la tradition
religieuse.
La même question – comment une tradition peut-elle prendre sens dans le présent, être lue comme
la loi de l’avenir ? – mérite une autre approche encore.
L’entrevue avec Monseigneur Zakarian avait lieu un dimanche et l’évangile du jour était ce passage
de Matthieu 12, 1-8 qui concerne le non-respect du sabbat juif : « Ou encore n’avez-vous pas lu
dans la loi que le jour du sabbat les prêtres dans le Temple violent le sabbat sans être en faute ? Or,
je vous le dis, il y a ici plus grand que le Temple. Et si vous avez compris le sens de cette parole :
c’est la Miséricorde que je désire et non le sacrifice, vous n’auriez pas condamné des gens qui sont
en faute ».*
Jésus s’adresse aux pharisiens, aux meilleurs et aux plus fanatiques des gardiens de la loi. Il leur
dit : « Si vous saviez ce que je veux dire lorsque j’attends de vous la miséricorde et non le
sacrifice ».
Pour des oreilles modernes, le mot de « miséricorde » peut paraître à son tour bien désuet, comme le
mot de « batgam « , il y a un instant. Il y a une obligation, celle de renouveler les concepts qui ont
perdu de leur éclat. Renouveler, cela signifie mettre les concepts en mouvement, les retourner à leur
origine, les replacer dans leur lie de naissance, en un mot les rendre à nouveau étrangers et lointains
pour qu’ils deviennent enfin parlants à travers cet éloignement même. Or, ce qui est attendu de nous
à l’égard du mot (mais aussi de l’idée de miséricorde, c’est ce qui était déjà exigé par le premier
prêtre de la nouvelle Alliance à l’égard de la loi juive. Car le « sacrifice » dont il est ici question est
à entendre par rapport à la tradition de la loi. Qu’est-ce que cela veut dire : se soumettre à la loi
comme victime ? Cela signifie oublier l’essence et l’origine de la loi, oublier ce qui en constitue la
vie, ce sans quoi elle serait lettre morte. Celui qui oublie l’essence et l’origine répète la tradition en
se détournant de la nécessité de la renouveler. Il en répète les conceptions reçues au lieu de se
consacrer à sa réception créatrice. Deux mille ans après, dans des conditions collectives qui n’ont
pas leur précédant, c’est donc la même exigence de renouvellement qui s’impose. Mis il y a autre
chose encore : il y a dans le terme « miséricorde » ce que nous avons appelé le mouvement des
cœurs. Ce ne sont pas les règles et les lois qui vont rédimer le fils de l’homme, par miracle, s’il n’y
a pas le renouvellement intérieur de ce qui, en chacun, forme la dimension communautaire.
Le mot « դաւձ – darts » a en arménien le double de sens de retournement et de conversion. Un
retournement et une conversion sont nécessaires sur tous les plans, celui de la politique, celui de la
littérature, celui de l’interprétation, pour que l’on cesse de se soumettre comme victime (c’est bien
le mot « victime » que porte la traduction arménienne du passage cité de Matthieu) à une tradition
répétée certes, mais non reçue dans le renouvellement de la dimension communautaire. C’est ce
retournement et cette conversion, cette mise en mouvement des cœurs, qui sont nommés par la
« miséricorde ».
Mais pour l’habitant de la diaspora, dans l’immédiat, qu’est-ce que la Miséricorde ?
Il est écrit : « Car le Fils de l’Homme est le maître du sabbat ».
Lorsque l’habitant de la diaspora cessera un moment de fuir l’épars, la dislocation, qui sont pourtant
son lot le plus commun, lorsqu’il cessera de les nier et de les éviter, il se fera le maître de ce
moment, il s’y renouvellera. Est-il vidé de sa dimension communautaire ? Ce vide deviendra l’objet
même de son activité (le vide, en arménien, se dit « պաւապ – barab », l’activité « պաւապոմ –
baraboum). Je reprends ainsi une phrase prononcé à peu près textuellement par Monseigneur
Zakarian. Ceci se traduit concrètement dans son esprit par la constitution de petits groupes pour que
soit revivifié ce qui restait lettre morte, pour que la parole sacrée renaisse et trouve un terrain
favorable dans les cœurs et les esprits.
La seconde partie va maintenant se rapporter à une actualité plus immédiate. Elle s’efforcera de
cette façon de remédier quelque peu au manque d’informations, pour aboutir à son tour aux
questions essentielles. L’exposé avance cette fois par questions et réponses.
MN (Marc Nichanian) : Quels ont été les résultats de la dernière visite du Catholicos à Paris ?
MGR (Mgr Zakarian) : Sa Sainteté le Catholicos Vazken 1er se trouvait à Paris au mois de juin
1984. Une réunion a été organisée par le biais de l’Église de Paris. A cette réunion étaient conviés
les évêques des trois diocèses de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que les représentants laïques des
différentes paroisses. Cela se passait le 8 juin. Sa Sainteté Vazken 1er a fait un rapide historique au
sujet des questions statutaires, en parlant en particulier de la Constitution nationale à l’intérieur de
l’Empire ottoman et du « Bologenia » dans l’Empire russe, dans les deux cas donc avant la première
guerre mondiale. L’Église avait sa place à l’intérieur de ces cadres. Puis, il a expliqué comment les
évènements historiques ont bouleversé la configuration de notre Église. Dans un certain nombre
d’endroits, notre Église a aujourd’hui des statuts solides et cohérents, mais dans bien d’autres
endroits, c’est loin d’être le cas. La France fait partie de cette dernière catégorie. Ce que souhaitait
Sa Sainteté, ce qu’il a même demandé expressément, c’était que l’on prépare de nouveaux statuts
dans chacun des diocèses, mais cette fois de façon homogène. L’amélioration des statuts existants,
mais surtout leur homogénéisation, étaient à l’ordre du jour. Il y a en effet de nombreuses
imprécisions dans les statuts actuellement en vigueur, qui avaient été adoptés sans concertation
réciproque. Un exemple de cette imprécision: rien n’est prévu dans les statuts concernant les modes
de candidature et d’élection d’un nouveau prélat.
Sa Sainteté le Catholicos a souhaité, de plus, que soit constituée une « Organisation diocésaine de
l’Église apostolique Arménienne de France », pour regrouper et représenter l’ensemble des
Arméniens vivant dans ce pays. Les formalités concernant la rédaction des nouveaux statuts ont été
laissées aux soins des représentants des trois diocèses. Il faut qu’un an au plus tard après la date que
j’ai indiquée les statuts aient été rédigés pour être ensuite soumis, avant leur mise en application, à
l’approbation du Catholicossat.
MN : Que devient alors le titre de délégué apostolique ?
MGR : Feu Monseigneur Sérovpé Manoukian avait effectivement deux titres, ou deux fonctions
différentes. : il était d’une part le prélat du diocèse mais il était d’autre part le délégué apostolique
du Catholicos pour l’Europe occidentale. Il faut savoir que cette seconde fonction est entièrement
liée au Siège du Catholicossat. C’est Sa Sainteté le Catholicos qui a le pouvoir de nommer un
délégué apostolique, et lui seul. Jusqu’à présent, après la mort de Monseigneur Manoukian, une
telle nomination n’a pas été prononcée. Il n’est peut-être pas superflu non plus de donner une
explication sur la tâche du délégué apostolique. Un délégué apostolique est nommé en général pour
un apostolat précis. Lorsque cet apostolat est mené à terme, l’appréciation de la nouvelle situation
est entièrement à la discrétion de Sa Sainteté le Catholicos.
MN : Comment la situation statutaire qui a cours à l’heure actuelle se concilie-t-elle avec la
tradition démocratique de l’Église arménienne. Il faut bien dire que cette tradition a pris des allures
plus ou moins mythiques de nos jours.
MGR : En France, les minorités religieuses sont toutes constituées en tant qu’associations
cultuelles. Il y a ainsi des associations cultuelles juive, protestante, islamique, ou grecque
orthodoxe. Seule, l’Église catholique qui est l’Église de France échappe à ce cadre général. Les
associations cultuelles préparent leurs statuts, chacune selon ses principes. Les conditions
démocratiques sont respectées dans la mesure où les fidèles ont pour devoir de faire partie de ces
associations. Dans les autres communautés dispersées dans le monde, la situation est parfois
sensiblement différente. Elle peut l’être sur des points de détail comme en Amérique du Nord où les
prélats ont des mandat limités. Elle peut l’être fondamentalement comme au Moyen-Orient. A
Beyrouth par exemple, on trouve une assemblée religieuse arménienne qui fait partie de l’assemblée
nationale arménienne, c’est-à-dire d’une représentation quasiment politique, sur le plan intracommunautaire. L’assemblée religieuse à son tour possède des sous-commissions comme le conseil
juridique. Le point essentiel reste celui-ci : au Moyen-Orient, une partie des attributs du pouvoir est
encore aux mains de l’Église.
MN : Si je ne me trompe, l’Église arménienne a eu un livre de droit canonique regroupant des
groupes de lois provenant de différentes époques. Quelle est la place de ce livre canonique dans la
vie démocratique de l’Église ?
MGR : Notre corpus canonique a été soumis à divers remaniements au cours des siècles, et il existe
aujourd’hui sous forme de « monument bibliographique » (l’expression est celle de l’Encyclopédie
Arménienne publiée à Erevan). Autrefois, lorsque l’Église avait pouvoir de juridiction, on utilisait
des manuels qui regroupaient des lois particulières. Et nous avons aujourd’hui une Commission qui
se réunit régulièrement à Etchmiadzine, au siège du Catholicossat, pour se consacrer à la rédaction
d’un nouveau corpus juridique.
Mais je dois dire que ce travail sur un corpus juridique propre à l’Église n’a pas de rapport direct
avec le remaniement statutaire dont il a été question. Pour l’Église Arménienne en France,
actuellement, il est important d’avoir des statuts cohérents. Mais là encore, ce n’est pas suffisant.
Ces statuts seraient-ils rédigés sur du marbre qu’ils ne changeraient pas un iota à la situation
actuelle si nous continuons à nous comporter comme aujourd’hui, dans l’indifférence la plus totale.
L’essentiel, de mon point de vue, est de rendre à l’Église sa vitalité, pour qu’elle puisse enfin
remplir son rôle dans la diaspora, ce qu’elle ne fait pas en ce moment, ce qu’elle n’a pas su
faire jusqu’à présent.
MN : Au début de notre entretien, il était question de la nécessité d’assumer l’exil, et ceci d’abord
sur le plan théologique. Y a-t-il eu à cet égard un échange d’idées avec le Catholicos ?
MGR : Sa Sainteté a prononcé une phrase remarquable, dont à ma connaissance, seul le journal
« Haratch » s’est fait l’écho (12 juin 1984). Il a dit que la diaspora est aujourd’hui une réalité
irréversible. Ce qu’il faut, à mon avis, comprendre de deux façons. Tout d’abord, c’est un fait que
plus de la moitié des arméniens habitent hors des frontières politiques de l’Arménie. Au-delà du
fait, il faut faire une constatation : il y a quarante ans, les arméniens de la dispersion pensaient
qu’un retour allait se produire. Ils vivaient et se comportaient dans cette optique. Depuis, cette
psychologie a eu le temps de se modifier de fond en comble. En conséquence, notre tâche à nous est
d’abord d’assumer l’exil, de toutes les manières possibles. L’une d’elles est le travail théologique.
Mais Sa Sainteté le Catholicos a de plus insisté à plusieurs reprises sur le fait que la diaspora ne
pouvait faire de plus grand présent à l’Arménie que de créer des écoles à fonctionnement quotidien
dans les différentes communautés.
Je dois dire que j’ai eu souvent l’occasion de vivre des désillusions sur ce plan-là. Les laïques qui
participent aux affaires de notre Église prétextent que leur vocation est purement patriotique. Elle
n’a pas le soutien d’une foi religieuse. Mais, je vois bien que sur l’autre plan également, celui des
affaires de la nation, ils ne font pas grand chose. Et je me demande en moi-même : comment
l’Église peut-elle continuer à exister dans ces conditions ?
Et je ne parle même pas de la signification, ou de l’absence de signification, d’une activité mue
par le pur souci « national », lorsqu’en réalité, c’est le vide qui règne en maître.
C’est cela que signifie entre autres l’opposition entre le « sacrifice » et la « miséricorde » dans
l’évangile de ce jour.
Même le rituel est réduit chez nous à un formalisme. Je voudrais parfois crier : ne conservez
pas les formes lorsque la possibilité même de la prière s’est évanouie. En fin de compte, nous
ne sommes même pas les gardiens de la Loi comme l’étaient les pharisiens. Chez nous, tout est
réduit à l’état de folklore.
De sorte que, s’il est vrai que les remaniements statutaires sont indispensables, il faut qu’ils aient un
impact dans la vie même des fidèles et donc de l’Église. Sinon, ils n’auront aucune portée et aucune
influence.
C’est vrai, mon souci est celui du sens, du contenu interne auquel je voudrais voir revenir notre
Église. Mais vous savez que ce terme d’Église a deux acceptions différentes. D’une part, il désigne
l’Assemblée du peuple de Dieu fondée sur la personne du Christ. D’autre part, il désigne ce
bâtiment dans lequel on accomplit les sacrements. C’est bien dans le premier des deux sens que
j’entends l’Église, lorsque je dis que c’est le vide qui règne en maître.
L’Église est vidée de ce qui devrait la fonder en tant qu’Assemblée du peuple de Dieu.
Et moi, je ressens cela de tout mon être. En 1980, à Jérusalem, nos ecclésiastiques étaient
rassemblés. Ils venaient de tous les continents et je voyais en chacun d’eux la même souffrance, la
même cris latente, due à la défection du sens. Mais, il se trouve aussi que chacun attendait de son
voisin un remède à cet état de choses. Il faut bien que quelqu’un commence à s’occuper de ces
questions en s’y engageant pour une fois entièrement.
MN : Vous-même, comment voyez-vous les remèdes à apporter ? Quelle sont les mesures que vous
envisagez ?
MGR : Il y a d’abord le travail d’évangélisation dont notre Église ne s’occupe pas, tout du moins
en Europe. Il y a le travail d’enseignement. J’aurais voulu qu’il existe un « Conseil de
l’enseignement » se préoccupant de l’éducation chrétienne des générations à venir. Il devrait
entreprendre un travail de longue haleine dans le but de recréer la conception du monde qui nous est
nécessaire. Un tel effort de recréation et d’élaboration est tout simplement absent de notre Église.
La foi est une question subjective. Ce qui, par contre, est objectif, c’est ce devoir, cet impératif de
recréation. Et cela dépend entièrement de nous.
Jusqu’à présent, nous n’avons pas pu réussir à rassembler les fidèles, à les mettre côte à côte, à en
faire en peuple religieux, indépendamment du formalisme patriotique. Je ne suis pas sûr par
exemple qu’il y ait autour de moi une communauté rassemblant cinquante véritables fidèles !
C’est pourquoi j’estime que la question prioritaire est l’initiation d’un mouvement interne
plutôt que le remaniement statutaire. Les travaux élémentaires dans ce sens n’ont pas été
effectués, le souci du rassemblement a été négligé, la nécessité de nous refonder comme
Assemblée du peuple de Dieu a été méprisée. Mais le Christ ne disait-il pas : « Qui ne
rassemble pas avec moi disperse » ?
MN : Le souci d’un enseignement chrétien et d’un mouvement à créer se croisent ici avec le souci
théologique. Je suppose que les deux ne sont pas sans rapport.
MGR : Bien sûr que non ! Les grecs orthodoxes ont en France un centre habilité à représenter
de façon officielle le point de vue de l’Église orthodoxe. Notre Église se déclare apolitique.
Fort bien. Mais à côté de cela, a-t-elle une doctrine religieuse qui lui soit propre ? A-t-elle
développé en quelque lieu sa vision du monde, sa philosophie ? Elle accomplit sans faille les
tâches du culte. Mais elle n’a pas pu créer un centre analogue à celui de l’Église orthodoxe, un
lieu d’études, qui fut en même temps le noyau d’un mouvement.
La « théologie de l’exil », en ce sens, est devenue une désignation commode que d’autres se sont
appropriée pour la porter à des proportions sans commune mesure avec sa signification réelle. Cela
avait déjà été le cas autrefois pour la pensée diasporique. Or, toute la question est de s’asseoir et de
rassembler les prémices d’une telle théologie, de la mettre sur pieds et de l’enseigner. Je puis même
dire que cette idée est venue en partie des laïques. J’aurais voulu par exemple étudier une théologie
de l’exil en commençant par ce fondement que fournit la littérature contemporaine en diaspora.
C’est en effet avant tout une question de parole et le lien avec la poésie est indéniable. Mais, c’est
également à travers la littérature que l’on peut comprendre au mieux ce qu’est la dispersion, comme
retrait de l’absolu. Les références bibliques ne peuvent prendre leur sens qu’à partir de là.
C’est ainsi que je vois le noyau d’un mouvement interne : à travers un travail en petits groupes, en
cellules, dans les conditions fournies par un centre de création, où une philosophie viendrait
effectivement à naître, ce que j’appelle une conception du monde. Mais où les questions pourraient
également être débattues dans leur aspect quotidien pour être ensuite propagées. Si dans le cours de
cette propagation, on venait à rencontrer des obstacles, un retour serait toujours possible vers ce
centre d’études, de création et de prières. Car là où il y a des impasses, il ne faut pas les éviter, il
faut les comprendre. Nous avons toujours tout fait au contraire pour éviter nos propres
impasses alors qu’il fallait au moins se consacrer à la compréhension de nos manques.
MN : La question d’une création « interne » est liée pour vous également à celle d’une
représentativité « externe ».
MGR : Ici encore, il est difficile de séparer les deux. « Interne » et « externe » sont dans un état
-qu’on me passe le mot- lamentable. Il n’y a ni rassemblement interne ni représentativité
externe. Prenons les débats que l’on peut lire aujourd’hui sur les héritages respectifs laissés par le
monde sémite et par le monde grec sur les conceptions chrétiennes. On voudrait vois chez les
arméniens un intérêt pour de tels débats et une participation à leur formulation. Or, la question d’un
mouvement interne, autant que celle d’une représentativité, sont liées à un problème d’identité.
Il ne suffit pas de dire que l’Église est le support de notre existence nationale. Cela reste une
formule tant que cette Église est vidée de sa moelle, tant que nous demeurons incapables de
dire, c’est-à-dire probablement de traduire dans le présent ce qui la caractérise et ce qui la
différencie. Pour les arméniens d’ici, l’Église est un fruit exotique. Comment pourrait-on goûter
le fruit lorsqu’on n’en connaît ni l’aspect, ni la chair ?
Que le travail d’évangélisation commence, que les laïques aussi bien que les ecclésiastiques
commencent un peu à se soucier du dire et du traduire, à ce moment-là peut-être une tradition
de la dispersion pourra-t-elle commencer à se fonder. Mais si cela ne s’accomplit pas, on peut
dès maintenant tracer une croix sur la vie diasporique.
* L’ensemble de cette œuvre a été écrite à Jérusalem entre 1940 et 1944. Le volume 9 a paru à
Antélias sur les presses du Catholicossat de Cilicie en 1981.
* Traduction de la Bible de Jérusalem.
- Contactez-nous
- Adhérer
- Faire un don
- Rechercher
INTERVIEW DE MGR ZAKARIAN PAR MARC NICHANIAN 1984
Conception & réalisation : Bonsirven Design